
Bernard Vitet démystifie la respiration continue :
Cet article a pu être reconstitué grâce aux éléments que j’ai pu récupérer dans mes archives et aussi à ceux que m’ont fait parvenir Hélène Sage et Jean-Jacques Birgé.
Je me suis permis de refaire la plupart de illustrations illustrant l’article, afin des les rendre plus compréhensibles. J’ai aussi complété ce texte avec une interview de Bernard, consacré au souffle continu, paru dans Jazz-Hot.
Francis
(Recommandation importante : une lecture active est nécessaire à la clarté du texte. Pratiquer en lisant.)
l. - LA RESPIRATION OXYGÉNATOIRE

ANALOGIE DE LA BOUTEILLE SANS FOND
Une traction au centre de la membrane crée un vide dans la bouteille, d’où appel d’air dans les ballons qui se gonflent.
A la détente de la membrane correspond évidemment une expulsion de I’air hors des ballons qui se dégonflent.
Activité pulmonaire : phénomènes analogues.
ANALOGIE DU TlR A L’ARC
Vu en coupe, le diaphragme évoque l’arc. Son comportement l’y assimile. Pendant le bandage de l’arc l’énergie s’accumule (+) dans celui-ci (inspiration).
L’arc relâché, cette énergie est libérée (-) dans le sens de la flèche qui est propulsée (expiration).
La respiration oxygénatoire peut donc être ramenée à un cycle binaire de tension (+) / détente (-).

ANALOGIE DU PISTON
C1 : La morphologie des poumons les assimile clairement à un cône exinscrit. Un simple examen des croquis C2 et C3 révèle l’avantage de l’inspiration abdominale sur l’inspiration thoracique du point de vue de la quantité de stockage de l’air comme de celui de l’économie d’énergie.
C2 : inspiration : effort de l’ensemble de l’appareil musculaire intercostal = stockage maximal de l’air dans la partie la plus étroite du cône.
Expiration : non axiale. Le soufflet en se refermant repousse l’air à partir de le périphérie de l’appareil et du haut vers le bas du diaphragme, contrariant ainsi partiellement le travail de celui-ci.
C3 : inspiration : effort concentré à la base et dans l’a×e de la colonne d’air.
Expiration : effort concentré sur l’axe du corps et de l’émission du bas vers le haut (sens de l’expulsion). Contrôle de la compression de l’air exercé en un point, le centre du diaphragme. Ce type de fonctionnement assimile dans ce cas l’appareil respiratoire à un piston.
ll. - LA RESPIRATION SONORE
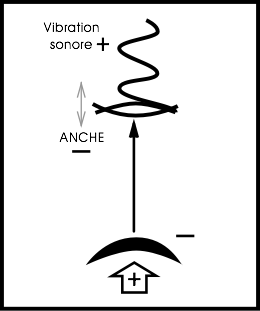
S’il y a production de son à l’expiration (ou, exceptionnellement, a l’inspiration), le système se complique : l’énergie libérée par la détente du diaphragme (-) est alors transformée en vibration sonore utilisant pour cela l’élasticité d’anches diverses (cordes vocales, voile du palais, langue, lèvres, roseaux) ou l’inertie d’un biseau (flûte, sifflement). ll faudra à cette transformation un supplément d’énergie (+).
L’effet d’une poussée régulière et adéquate (direction, concentration et intensité) de l’air sur l’orifice variable que constitue l’anche (simple ou double) est l’obturation et l’ouverture alternatives de l’orifice, selon une fréquence régulière donnant naissance à un son de hauteur constante. La qualité de ce son sera fonction de l’équilibre entre la pression appliquée à la colonne d’air et la relative rétention exercée au niveau de l’orifice.
La respiration sonore observera donc le schéma ternaire suivant :

Rôle de la sangle abdominale.
ANALOGIE DE LA POMPE HYDRAULIQUE :

Le volume V des viscères, entre la sangle abdominale et le diaphragme, se compose essentiellement d’eau. Son comportement mécanique l’assimile à une grosse bulle liquide, donc incompressible. Toute pression exercée par le diaphragme vers le bas sera par conséquent répercutée intégralement sur la sangle abdominale et vice versa. Grâce à cette propriété, la projection de la sangle vers l’avant va, à l’inspiration, permettre au diaphragme un mouvement plus ample et moins coûteux en effort (moindre résistance). A l’expiration sonore, la tension de la sangle restée contractée va fournir au diaphragme, dans l’axe de l’émission, le supplément d’énergie nécessaire.

Inutile de rentrer le ventre. La partie supérieure du corps, en se tassant, comprime l’air contre la sangle (restée tendue) à la façon d’un accordéon qui se vide progressivement si on le pose sur le côté.
Rôle de la langue
Dans tous les cas, sauf celui de la vocalisation (où la compression de l’air se fait directement entre le diaphragme et les cordes vocales), c’est la langue qui a pour fonction, en se rapprochant plus ou moins de la voûte (dure) du palais, de réguler le débit et l’état de compression du jet d’air projeté sur l’anche ou le sifflet. En effet, qu’elle soient actives (lèvres) ou passives (roseaux), le rôle des anches n’est pas de procéder à cette régulation, mais seulement d’être placées dans les conditions d’élasticité optimale pour émettre le son désiré.
La colonne d’air peut être schématiquement décrite comme un cône tronqué fermé à sa base et percé à son sommet, la compression de l’air qu’il contient étant obtenue et modulée d’une part par la ceinture abdominale puisant à sa base, la langue réglant d’autre part le débit au sommet (prononciation phonétique : i fermé).
III. LA RESPIRATION CONTINUE

Le procédé consiste, à l’expiration, à entretenir, par un travail purement buccal, l’expulsion de l’air, tout en inspirant très rapidement par le nez. Le voile du palais obture la cavité buccale et l’isole du reste du système respiratoire. Dans le même temps, la langue, se contractant, se gonfle, réduisant le volume de la cavité buccale et imprimant ainsi à l’air resté dans la bouche la compression nécessaire à l’entretien de la vibration. Simultanément, inspiration instantanée par les fosses nasales, seules alors en communication avec le reste du système. On repasse ensuite, par un nouveau cycle, à la phase d’émission normale.
On rencontrera dans la pratique de la respiration continue deux possibles difficultés.
1. Difficulté d’ordre neuromoteur : il est inhabituel et apparemment contradictoire de réaliser dans le même temps les gestes d’une expulsion de l’air (bouche) et ceux d’une inspiration (nez).
Exercice : se remplir la bouche d’un bon verre d’eau (joues gonflées), la vider en produisant un jet aussi loin et aussi longtemps que possible, recommencer en inspirant par le nez pendant toute l’opération du jet.
Autre exercice : pendant le jet inspirer et expirer indépendamment par le nez.
2. Difficulté d’ordre aérodynamique : pour que le son soit continu il faudra exactement conformer la compression créée dans la bouche à l’instant de l’inspiration nasale à celle réalisée dans les phases précédente et suivante d’émission normale.
Exercice : s’exercer à souffler à l’aide d’une paille dans un verre rempli d’eau ; au cours de l’inspiration nasale le débit et le volume des bulles ne doit pas varier.
La respiration continue libère le phrasé des instrumentistes à vent des contraintes de la capacité pulmonaire.
Bernard Vitet
EXPLICATIONS DES CROQUIS

1. En pointillé, c’est le volume des viscères. C’est cette boule d’eau. J’ai partagé les muscles de la respiration en deux catégories : les muscles + et les muscles -. Les muscles sont + dans la mesure où ils sont à l’origine d’une action. Les muscles - contribuent à cette action, mais ne la déterminent pas. Leur rôle est consécutif. Les muscles + , ce sera le diaphragme puis cette sangle abdominale. Le diaphragme est déterminant dans l’inspiration et moins dans l’expiration et la sangle abdominale a un rôle analogue. La langue règle le débit de la colonne d’air, la compression avec le diaphragme et la sangle abdominale. L’action psychomotrice va d’abord s’exercer dans ces trois endroits. La musculature - c’est celle de la trachée artère, des bronches et des bronchioles. L’ensemble de ces muscles accompagne toutes les variations de pression, pour ne pas les annuler. Quand il y a plus de compression, que ça se resserre vers le centre, tout ça se détend, et les muscles intercostaux accompagnent le mouvement. Leur principale utilité est d’abord de protection (solide mais souple). C’est une action légère sur les variations de volume, et surtout pas déterminante. Les muscles de la face contribuent à l’état des lèvres, mais c’est également consécutif. Les lèvres (dans le cas de la trompette) doivent être dans de bonnes conditions pour vibrer, c’est-à- dire être tendues jusqu’à une certaine limite. Au-delà de cette limite, elles vibrent moins bien. Elles produisent des sons moins timbrés, il y a moins de dynamique, on passe moins facilement d’une note à l’autre. Au contraire, plus cette tension est idéale, c’est-à-dire très légère, très douce, plus les sons qui sont émis vont être variables, modulés, économiques. Plus l’air sera comprimé, moins il y aura de débit. Plus l’air sera tendu et plus il créera un impact efficace sur les anches (des lèvres).

2. Les deux colonnes d’air opposées par le sommet. Ici, j’ai mis un sommet virtuel qui est l’oreille. Ce sommet virtuel se trouve exactement à la place de l’oreille interne, à l’intérieur de la tète. Il faut dire que la vibration est dans toute la colonne d’air, c’est-à-dire que non seulement on peut prendre un son en mettant le micro dans l’embouchure, mais le son est partout, il retentit sur le diaphragme, il est partout à l’intérieur. Je pense que si on mettait un micro dans le diaphragme, on entendrait le son de l’instrument. Ce son sature la colonne d’air sur toute sa longueur et au niveau de l’émission, c’est-à-dire de la prononciation, à cet endroit fatidique dont je parle tout le temps, sur le « i », si la compression est grande et si le timbre est particulièrement riche, c’est-à-dire sur un « i ›› très fermé, ces vibrations sont perçues par l’oreille interne, directement par contact, ce qui fait que quand on joue vraiment sur le timbre de cette façon-la, particulièrement dans l’aigu où ça devient de plus en plus évident, on entend le son éclater à l’intérieur de l’oreille interne. Ce n’est plus le son qui sort du pavillon, fait le tour et rentre dans le cornet acoustique, c’est une impression qui est intérieure et je me base beaucoup sur ce son interne pour jouer, parce que ça veut dire qu’il y a une qualité de compression, de vibratilité de la colonne d’air qui est particulièrement grande quand on entend ce son la.
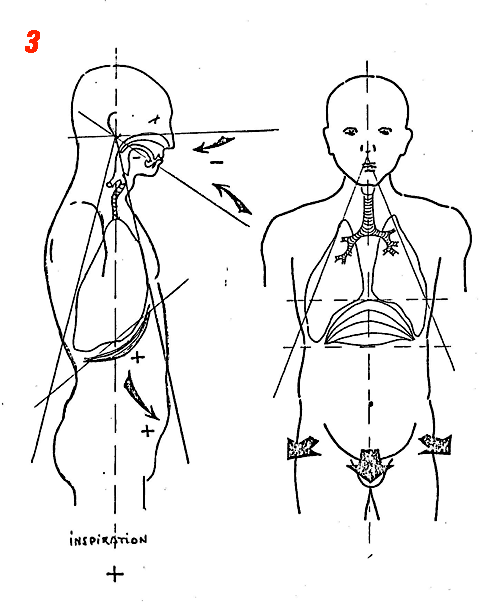

3. J’ai mis ces trois flèches pour signifier qu’il y a d’abord une concentration ici, mais que cette concentration entraîne d’autre part consécutivement des répercussions sur l’attitude du bassin, c’est-à-dire quand on concentre vraiment l’attention vers le bas de la colonne d’air, on a même un peu l’impression que les articulations de la hanche se détendent. On a l’impression que le bassin s’élargit, ainsi que l’anus et les organes génitaux, il y a une dilatation que je représente par les trois grosses flèches noires. Ce n’est pas un mouvement qu’on cherche à faire, il se produit comme ça, quand on se concentre ici c’est comme quand on va chier. La fonction aérienne du diaphragme est très importante parce que c’est une fonction directement vitale, mais elle est aussi très importante, particulièrement dans sa phase de tension, dans l’orgasme, dans la défécation, la miction, l’enfantement, tout ça. Au niveau du travail technique, entretenir les sensations du corps, c’est aussi important parce que plus tu entretiens les sensations, plus tu es capable de les recréer. Il faut les préciser.
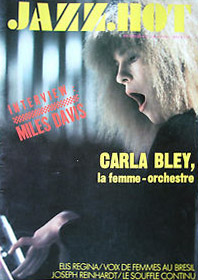
INTERVIEW avec Bernard Vitet
article publié dans le numéro 394 de Jazz-Hot.
Jazz-Hot. - Tu sais pratiquer le souffle continu, mais tu ne l’utilises pas dans ta musique ?
Bernard Vitet. - Il peut arriver qu’on ait besoin de faire des phrases ininterrompues, en boucles, mais je ne base pas mon phrasé sur le souffle continu. Mais finalement, je peux dire aussi bien que je m’en sers sans arrêt parce que ça correspond à une certaine façon de souffler : il y a des points d’équilibre vraiment très très justes à trouver entre la concentration des gestes, la quantité d’air et le mode de compression de l’air. Si cet équilibre n’est pas réalisé, on peut ne pas s’en rendre compte. Par contre, avec le souffle continu, c’est révélateur. Si cet équilibre n’est pas réalisé, il se passe des trucs, le son tend à se détériorer : soit on s’asphyxie parce qu’on n’a pas assez d’air, soit plus généralement parce qu’on en a trop. On se gonfle trop facilement, on utilise moins d’air qu’on n’en aspire à chaque fois et on se gonfle de plus en plus, ce qui fait que le son finit par s’interrompre. Il faut un certain débit pour produire tel son, en hauteur, en timbre et en amplitude. Ça correspond à une quantité exacte d’air et de compression. ll y a des gestes particuliers pour avoir tel son. Si cette économie n’est pas absolument respectée dans le souffle continu, comme il s’agit d’un phénomène cyclique, ce phénomène tend à s’amplifier au fur et à mesure que ça continue. Par exemple, si on n’est pas bien placé sur le timbre, à mesure que le processus continu se développe, le timbre se détériore de plus en plus par exemple, ou bien ce peut être au niveau du volume (de moins en moins fort ou au contraire de plus en plus fort). Ce travail sur le souffle continu donne un exercice très juste de cette économie et comme c’est ininterrompu, tu peux vraiment travailler dessus, tu vois comment ça se développe, si tu tends à une stabilisation ou au contraire à une déstabilisation, on s’en rend très bien compte. Alors finalement, même quand je ne joue pas des sons continus, c’est-à-dire la plupart du temps, je me sers toujours du souffle continu.
J .H. - Les musiciens du Maghreb ou du Tchad islamisé et les musiciens indiens n’ont pas du tout le même masque. Les musiciens africains ont les joues distendues, ce qui n’est pas le cas des musiciens indiens.
B.V. - On le voit particulièrement sur un instrument à anche double, parce que c’est là que ça marche le mieux, étant donné que l’anche double peut être considérée comme une anche libre, selon la façon dont on en Joue : on peut pincer ou ne pas pincer l’anche. Quand on ne la pince pas, on crée une chambre de compression en gonflant les joues ou sans les gonfler, là n’est pas la question.
J .H. - Effectivement, les joues gonflées correspondent aux régions où on ne pince pas l’anche.
B.V. - C’est ça. Si tu pinces l’anche (et les lèvres, c’est une anche) tu ne peux pas jouer en gonflant les joues. Enfin, je dis ça, mais Dizzy Gillespie n’y arrive pas mal. On peut jouer en gonflant les joues. En fait, moi, je préfère ne pas le faire. Ce n’est pas indispensable...
J.H. - Dizzy ne fait pas le Souffle Continu ?
B.V. - Je pense qu’il peut le faire à mon avis il a du travailler sur une technique de ghatta (petit hautbois maghrébin), quelque chose comme ça. Il a dû travailler le souffle continu mais il ne joue pas de sons continus.
J.H. - Parce que ça ne I’intéresse pas esthétiquement...
B.V. - Tout dépend de sa propre économie du son. Je pense que sur la trompette, ce n’est pas nécessaire de gon ?er les joues parce que finalement il n’y a pas besoin d’une grande quantité d’air. ll y a besoin d’une moins grande quantité d’air que pour la voix ou pour la flûte, particulièrement la flûte traversière. Ça crée une plus grande compression, la trompette. Moi, je ne ressens donc pas le besoin de comprimer beaucoup les lèvres pour jouer. Au contraire, j"essaye de les serrer le moins possible l’une contre l’autre et de tendre latéralement le moins possible les muscles buccinateurs. J’essaye au contraire d’arrondir les lèvres et de jouer le plus possible sur des mouvements plus souples des lèvres, ce qui m’interdit de gonfler les joues, parce que gonfler les joues, ça veut dire pincer ’assez’ fortement les lèvres, ce que je ne fais pas. Je sais qu’il n’est pas du tout nécessaire de les gonfler. La réserve qui est dans le volume normal de la bouche est largement suffisante pour permettre d’expirer au moment où on inspire par le nez.
J.H. - Connais-tu les techniques traditionnelles où I’on souffle avec une paille dans un bol d ’eau ou dans du sable ?
B.V. - Oui, je les connais, mais je trouve qu’avec un instrument, c’est très bien aussi : avec une flûte, par exemple. Quand on souffle avec une paille, on apprend à faire ça en finesse, puisqu’il s’agit d’une compression très faible. L’air qui se trouve dans la paille est très, très faiblement comprimé. Pour arriver à une régularité absolue, qui est la condition absolument nécessaire au souffle continu, il faut créer un débit et une tension ininterrompus par rapport à une certaine pression. Évidemment, on ne change pas de note, quand on souffle avec une paille. Le tuyau a toujours la même longueur. La condition pour que le débit soit régulier est qu’il ne s’interrompe pas. C’est un mouvement pendulaire qui s’entretient de lui-même par sa fréquence comme tous les mouvements pendulaires, comme les mouvements des anches, etc. On utilise des cycles, des périodes. Pour obtenir la continuité, on doit obtenir une fréquence régulière, donc un débit régulier, une tension régulière des lèvres et les bulles doivent avoir toutes en moyenne la même grosseur et s’échapper de la paille d’une façon continue dans le temps, le même nombre dans une seconde, et à ce moment-là, il y a le souffle continu. En fait on recrée les conditions de la vibration d’une anche et tout ce qui ne contribue pas à l’établissement de cette stabilisation du débit et de la tension de l’air contribue à empêcher le son de s’entretenir.
J .H. - Peux-tu décrire comment ça se passe à l’intérieur du système rhino-pharyngé ?
B.V. - Ah oui, très bien. Mais ce n’est pas tant par rapport au souffle continu que par rapport à l’émission du son. Mais il faut parler de l’ensemble du système respiratoire. Je vais essayer de simplifier. Il y a d’abord la notion de colonne d’air. Mais « colonne ›› donne une notion de cylindre alors que je pense que la colonne d’air est conique et qu’elle est double, c’est-à-dire qu’il y a une partie de la colonne d’air qui se trouve dans le corps et une partie de la colonne d’air qui se trouve dans l’instrument. L’ensemble de ces 2 colonnes constituent 2 cônes opposés par le sommet.
J.H. - A la hauteur de l ’embouchure ?
B.V. - Justement. C’est la place de ce sommet, qu’on peut considérer comme une focalisation du son qui est déterminante. Le cône qui nous intéresse est celui qui se trouve dans le corps. La partie de ce double cône qui est dans l’instrument est très importante, mais on n’y peut rien : l’instrument est rigide, il est de forme inaltérable. Tout se passe avant le deuxième cône qui est totalement déterminé par la forme du premier. On pourrait dire que c’est une sorte d’entonnoir avec un trou en haut et à la base une membrane élastique, le diaphragme. On peut dire aussi (ce sera important par la suite) que ce cône est tronqué par une base à peu près à 45° et non pas horizontale. Le diaphragme travaille vers le bas. Ce faisant, il crée un appel d’air à l’intérieur de l’appareil respiratoire et la simple traction du diaphragme vers le bas fait pénétrer l’air dans les poumons (inspiration). Quand on inspire, on travaille. Quand on fait le son, on se détend. Ça ne veut pas dire qu’on ne travaille pas : on travaille à se détendre et cette détente produit un son, ce qui est important parce qu’on a toujours l’impression quand on produit que c’est le moment où on travaille. Or, en l’occurrence, ce n’est pas vrai.
J .H. - C’est l ’aspect Yin qui produit le son ?
B.V. - Oui, c’est ça. Ce qui fait que cette détente qui est moins est transformée en plus, c’est-à- dire en production concrète. Par contre, le travail d’inspiration, comme dans le tir à l’arc, le travail de la tension de l’arc, s’il n’est pas producteur, est le moment de la concentration, le moment où on accumule l’énergie qui une fois libérée sera transformée. Cette vision de la chose montre très bien que la plus grande efficacité dépend du rapport entre la quantité d’air et l’effort produit pour l’accumuler. C’est à la base de la colonne d’air qu’il y a le plus d’air, c’est- à-dire dans cette partie de la cage thoracique qui est au niveau de l’estomac, à partir du sternum. On voit bien que les poumons ont une forme conique et qu’en haut il y a très peu de capacité pulmonaire. En sorte que la respiration thoracique, qui est pratiquée de façon très générale, ne tend pas à une économie de l’inspiration puisqu’au prix d’un effort très périphérique qui engage tous les muscles intercostaux qui sont en grande quantité, au prix de cet effort qui n’est pas directionnel, pas centralisé, on fait pénétrer dans le corps une quantité d’air médiocre. Par contre, si on arrive à augmenter l’amplitude du mouvement diaphragmatique, on va libérer la partie des poumons qui a vraiment la capacité pulmonaire, là où on fait entrer le plus d’air possible avec le moins d ’effort possible. C’est ça qui est important. En plus, le diaphragme a un centre et le point le plus bas de son amplitude se trouve au centre. Il est å peu près circulaire et se bombe au centre, ce qui fait que le mouvement du diaphragme est particulièrement axial, directionnel. Quand on va tirer de l’air, on va le tirer vraiment par rapport à l’axe du corps. Ce mouvement va être centralisé, on va créer un piston. Une fois que cette énergie est accumulée, que l’air est entré (on accumule à la fois de l’air et de l”énergie, puisqu’on bande un arc), quand on relâche le diaphragme (c’est comme si on relâchait la corde de l’arc), non seulement, on relâche l’air, on le comprime vers le haut, mais on le com- prime dans l’axe du corps et on lui donne une efficacité particulière. On l’envoie dans une cible qui est le sommet du cône. Ce n’est pas comme dans un soufflet, ou en comprimant les bords du soufflet, on fait une pression latérale pour obtenir un mouvement vertical, dépense d’énergie énorme : il y a beaucoup de pertes. D’un seul point de vue mécanique, il y a beaucoup trop de frottements. Je n’ai pas parlé d’une chose très importante, à savoir le moyen de permettre au diaphragme de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, avec le plus de liberté. Ce moyen c’est de l’empêcher de rencontrer la résistance de cette énorme bulle d’eau qu’on a dans le ventre (le volume des viscères), jusqu’à 90 °7o, c’est de l’eau. Etant liquide, elle n’est pas compressible. Si le diaphragme dans son effort appuie sur cette boule d’eau, cette force est directe- ment répercutée sur la ceinture abdominale qui va du pubis au sternum et descend de chaque côté le long des côtes, et qui est également une sorte de membrane élastique qui reçoit cette poussée. Le meilleur moyen de ménager la place du diaphragme, c’est de déprimer, de pousser vers l’avant et vers le bas la sangle abdominale constituée de plusieurs muscles qui s’entrecroisent. Pour cette rai- son, on peut lui faire faire des mouvements très différents, par exemple la faire ressortir au niveau de l’estomac, au niveau de la ceinture, au niveau du bas- ventre. Si on la fait ressortir au niveau du bas-ventre, on est exactement dans le mouvement de l’axe qui n’est pas rigoureusement vertical mais se prolonge- rait plutôt légèrement vers l’avant. ll y a un point idéal, qui est exactement le périnée, qui est parfaitement dans l’axe. Si on pousse vers l’avant en faisant une sorte de boule avec la ceinture abdominale, le diaphragme va descendre plus bas et dans l’axe. Tout ça, c’est le travail, la concentration sur un point. On peut imaginer qu’on crée une sorte de boule de pierre å cette partie du ventre, de cinq centi- mètres de diamètre. Ainsi, le diaphragme arrive å sa meilleure amplitude, se détend, et si tout se détend, l’air ressort. Si maintenant on complique la chose en transformant cette expulsion de l’air en son, c’est- à-dire en production tangible, cette transformation va avoir besoin d’un apport d’énergie supplémentaire. Ce n’est pas une détente pure et simple. Si on chante, si on tousse, si on rote, si on produit un son quelconque avec l’appareil respiratoire å différents niveaux (pour la voix, c’est au niveau du larynx, pour la trompette, le saxophone, la flûte, au niveau de la bouche), si on transforme cette expulsion en son, on empêche l’air de sortir et cet empêchement et cette libération alternatives font le son. A ce moment-là, le diaphragme se détend, il ne peut pas se détendre plus ou moins (ou tout au moins je ne pense pas que ce soit très payant). Quand le diaphragme se détend, on le lâche d’un seul coup et selon la résistance à cette détente, l’air sort de telle ou telle façon. Si on crée cette résistance, il va falloir pousser. On va ajouter la pression de cette ceinture abdominale qui, elle, ne va pas se détendre. En fait, on se tasse dessus. Il va y avoir un mouvement dans tout le corps à ce moment-là. Le corps, de son propre poids, comme un *accordéon qu’on pose par terre, va s’appuyer sur cette ceinture abdominale qui, elle, reste ferme et ce tassement va se répercuter contre le diaphragme.
Je dis un tassement parce que ça contribue au système tension- détente, c’est-à-dire que lorsqu’on va inspirer, qu’on est en tension, on va s’agrandir et puis, nécessairement, il y a une sorte d’affaissement général, dû au poids. La boule de pierre reste une boule, c’est un acquis, et elle se détend aussi, mais plus progressivement. On peut cependant aussi penser à une technique où on la garderait en permanence. Cela dépend aussi de ce qu’on a à faire. Pour certaines partitions d’orchestre, å la trompette, qui se baladent pendant tout un morceau entre contre Ut et contre Fa, par exemple, je pense qu’il ne faut pas du tout interrompre la tension. On est assis dessus comme sur un cheval.
Passons au sommet de la colonne d’air : quand on veut faire vibrer une corde de violon, on la frotte à un endroit précis par rapport à l’enchaînement des nœuds et des ventres. On passe une ligne sur une ligne. Il suffit de mettre en vibration telle partie de la corde en tel endroit précis pour que la corde résonne d’une manière optimale et pourtant ce n’est pas une corde pincée, on entretient cette vibration en frottant l’archet de façon continue sur la corde. C’est très analogue à ce qui va arriver quand l’air passe sur l’anche, en particulier (je parle de ce que je connais le mieux) l’anche double des lèvres. La façon la plus rentable de mettre les lèvres en vibration, c’est de créer un impact au milieu de la partie vibrante des lèvres, c’est- à-dire devant l’embouchure, d’envoyer au centre de ce système d’anche comme une flèche, un jet d’air très centralisé. Je ne fais pas d’aérodynamique mais je me représente en tout cas que l’air est plus concentré, du fait de son mouvement, au centre de la colonne, dans l’axe du jet, que sur les bords et que ça dépend de la façon dont on le comprime dans le corps. Il y a des cartilages qui constituent en fait la trachée artère, les bronches et les bronchioles. Ils ont tous la même structure. C’est un cartilage avec un’ petit muscle. C’est un anneau qui n’est pas fermé et un muscle qui est utilisé pour serrer plus ou moins. Ce sont des muscles qui ont beau- coup d’importance parce que si on comprimait l’air entre le bas et le haut et qu’il n’y avait pas ce système d’amortisseurs, la com- pression ne se ferait pas. Du moment qu’on comprime l’air du bas vers le haut, on le com- prime également latéralement sur tout son parcours. C’est une parenthèse, mais qui est importante pour donner cette idée qu’on se condensé. quand on expire. L’ensemble du système a tendance à se concentrer sur l’axe de la colonne d’air. Alors, pour envoyer ce jet d’air particulièrement axial, pour obtenir la vibration optimale de l’anche, on va le faire passer par le conduit le plus petit au sommet de la colonne d’air, et ce plus petit conduit, c’est la langue qui le donne. Quand la langue est arquée dans’ ’la bouche, que sa pointe appuie sur les incisives inférieures et que les bords de la langue s’appuient comme on s’appuie sur une table pour écrire. La langue s’appuie sur les molaires pour se stabiliser et pour empêcher que l’air passe autre part qu’au milieu. La langue s’appuie comme un ressort sur les dents, sur les côtés et en avant et, en s’incurvant vers le haut, on obtient la prononciation « i ››. On n’a pas vraiment besoin de faire un gros effort parce que dans la vocalisation, il y a très peu de compression. La compression ne se fait pas là. Elle se fait entre les cordes vocales et le diaphragme. Le son est déjà émis quand l’air est passé à travers les cordes vocales donc il n’y a pas de compression dans la bouche quand on parle. ll y a des gens qui renoncent à faire le souffle continu, parce qu’il y a un moment difficile. Expirer en inspirant, c’est telle- ment contradictoire au niveau psycho-moteur qu’il faut être très méthodique et même si on est très méthodique, on enfreint une règle de comportement assez fondamentale. Ce n’est pas facile. ll faut prendre les gestes séparément, les analyser, savoir en quoi ils consistent, quel geste on fait pour obtenir quel résultat et puis ensuite commencer à les classer l’un avec l’autre comme lorsqu’on veut faire des triolets sur une musique à 2/2. On fait d’abord frapper les deux mains ensemble, ensuite la main droite va frapper un coup toute seule, ensuite les deux mains ensemble. Par la même décomposition, on va se dire : quand je souffle, c’est comme si j’avais de l’eau dans la bouche. Avec les lèvres, j’empêche l’eau de passer et en augmentant le volume de la langue et en la contractant, je vais chasser l’eau vers l’avant. Le bruit que l’on entend veut dire que les lèvres s’ouvrent et se ferment. Il faut faire attention que rien d’autre ne marche à ce moment-là, de ne pas avoir de mouvement de larynx ou de quoi que ce soit. On devient une bouche qui chasse l’eau, il y a une détente complète de tout, un geste qu’on fait n’en entraîne pas automatiquement d”autres. Par exemple, apprendre à utiliser tous les artifices de la prononciation orale sans que le larynx n’entre en action, que les cordes vocales ne viennent jamais couper la colonne d’air à leur niveau, apprendre à sérier les gestes, à les rendre indépendants les uns des autres, apprendre à faire cette émission sans que cela entraîne aucune autre activité par ailleurs. Une fois que l’on est arrivé à ça, on se dit : dans le même temps que je fais ça, il faut inspirer par le nez. Inspirer par le nez, ça engage le nez et le ventre. Au moment où on expire, on va pousser le ventre en avant, en ouvrant le voile du palais pour ouvrir les fosses nasales, les mettre en relation avec la poche d’air. Ce simple geste suffit, il n’y a pas besoin d’autre chose pour que l’air rentre.
J .H. - Quelle est la longueur de I ’inspiration ?
B.V. - Tu inspires très brièvement. Je disais que le tir à l’arc et la respiration c’était pareil, en fait c’est le contraire pour le rapport de temps. Quand on tire à l’arc, on peut passer dix minutes à tendre l’arc tout en visant, en se concentrant sur la cible, etc. Quand on relâche, ça dure quelques dixièmes de seconde. Quand on joue d’un instrument, il y a plus de son que de silence et c’est dans les silences qu’on peut respirer. Il y a donc toujours une inspiration brève, suivie d’une détente très longue, en essayant que les deux soient d’un seul jet. Quand on veut faire un « i ››, on n’essaie pas de pousser la langue au maximum en disant : je veux être sûr de pouvoir faire un « i ›› le plus fermé possible. Quand on dit « nouille ›› par exemple, on sent bien le mouvement de la langue, on sent bien que notre langue s’incurve et se colle au palais à un certain endroit, parce qu’après ce ne serait plus un « i ››. C’est là qu’on va trouver l’orifice le plus petit. La qualité du jet d’air émis par cette prononciation-là va donner la vibration optimale (j’appelle optimale celle où il y a le plus de timbre). Un son n’est pas une sinusoïde, c’est un spectre et il se caractérise par l’organisation particulière des composantes de ce spectre. Quand je dis timbré, je veux dire timbré dans l’aigu, c’est-à-dire le son qui contiendra le plus d’harmoniques aiguës parce que toute la mobilité de l’émission du son repose justement sur le contrôle des différentes harmoniques aiguës. Quand on pratique le souffle continu, on a également besoin de toute cette dynamique du son et cette dynamique, c’est justement cette richesse en harmoniques aiguës, et la sélection possible de ces harmoniques. Cette opposition des deux cônes par le sommet, ça sert un peu à donner une image de cette forme de la colonne d’air appropriée aux harmoniques du son. Plus on va fermer l’orifice, plus on va pousser le « i ›› dans ses derniers retranchements à l’endroit où ce n’est plus « i ›› en arrivant au voile du palais qui est très important dans le souffle continu. Quand ça va plus loin, on entend le voile du palais qui se met à battre. Il fait faire le « i ›› à l’endroit extrême où la voûte palatale n’est plus osseuse : c’est là où l’orifice est le plus petit, où le jet va partir le plus loin possible pour passer les lèvres exacte- ment au centre. Alors là, on va avoir un contrôle non seulement du timbre, mais une sélection de ce timbre très précise qui fait qu’on va même agir sur l’amplitude du son, ou que, sans agir sur l’amplitude, on va agir sur la puissance de la sonorité. Si on souffle plus fort, on augmente l’amplitude. Cette augmentation d’amplitude donne les harmoniques aiguës, alors qu’au contraire, si on enrichit le timbre en harmoniques aiguës, on donne une impression d’augmentation de puissance, sans que l’amplitude change. La bouche n’a pas la même fonction quand on chante, parce qu’elle est alors pavillon de la voix.
J .H. - Dans les clarinettes doubles du type « murali ›› (clarinettes rustiques indiennes comportant une calebasse entre le tuyau mélodique et le tuyau d’insufflation, et jouées avec le souffle continu), à quoi sert la calebasse ou sont logées les anches ?
B.V. - C’est une chambre de compression qui sert à régulariser ton débit. Au lieu que tu sois obligé de le partager en deux, tu envoies un débit moyen pour obtenir les deux sons. En fait, c’est pour remplacer la bouche. Si tu mettais ces deux anches libres directement dans ta bouche, elles t’empêcheraient de jouer parce qu’elles t’arriveraient jusqu’au fond de la gorge. Ce sont des instruments qui ont une anche très longue. C’est un peu différent parce que si les anches n’étaient pas plus longues que des anches de bombarde, on pourrait les mettre entièrement dans la bouche. Ce n’est pas tout à fait le même jeu parce que la chambre de compression n’est pas élastique, alors que celle de la bouche est élastique. Je travaille sur plusieurs projets, chacun étant vraisemblablement un livre et en particulier, un de ces projets porte sur la respiration et l’émission du son.
Bernard Vitet (Propos recueillis par Henri Lecomte)
article précédent : Joyeuses Fêtes
article suivant : Note d’un salmonidé